Propos recueillis par Lucie Sarfaty
Ancien élève de l'École normale supérieure, Lionel Naccache est médecin neurologue, professeur de physiologie à Sorbonne Université et praticien hospitalier à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce spécialiste des neurosciences cognitives, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), est membre du Comité national d'éthique depuis 2013.
Ses travaux sont consacrés à l'exploration des propriétés psychologiques et des bases cérébrales de la conscience. Ils croisent plusieurs approches complémentaires, dont l'expérience clinique de patients souffrant de troubles neurologiques ou psychiatriques, ainsi que l'étude de la cognition de l'homme sain et de l'homme malade à l'aide de paradigmes expérimentaux de psychologie cognitive combinés à des techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Auteur de nombreux essais à succès (Le Nouvel Inconscient, L'Homme réseau-nable ou Le Chant du signe), il a rédigé son dernier livre (Parlez-vous cerveau ? Odile Jacob, 2018) avec sa femme Karine.
L'engouement pour les nouvelles scientifiques sur le fonctionnement de notre cerveau correspond-il à une véritable révolution dans le domaine de la recherche ?

Nos 80 milliards de neurones sont des entités distinctes.
Comment les neurosciences cognitives, telles que nous les connaissons, sont-elles apparues ?
C'est une union entre deux champs scientifiques différents : d'une part, la théorie du neurone qui naquit au xxe siècle et, d'autre part, la psychologie cognitive qui est apparue dans les années 1950. Cette union entre théorie du neurone et psychologie cognitive est survenue durant les années 1980. Reprenons. Ce n'est que dans les années 1900 que l'on comprit que les neurones sont les unités structurelles et fonctionnelles de base du système nerveux, grâce aux travaux du médecin et neuroscientifique espagnol Santiago Ramón y Cajal. Avant lui, la question demeurait confuse. Certains scientifiques, dont Camillo Golgi, pensaient que les neurones en contact les uns avec les autres fusionnaient entre eux pour former de vastes et grandes cellules : ce que l'on appelle un syncytium. À l'inverse, Ramón y Cajal développa une sorte de conception individualiste des neurones : chaque neurone est isolé des autres par sa membrane et les points de contact entre neurones adjacents (les synapses) respectent bien ces individualités cellulaires. C'est assez intéressant d'ailleurs de relire les magnifiques schémas des neuroanatomistes et neuro-histologistes d'avant Cajal : on y voit bien des circuits de neurones complexes, mais il manque quelque chose : la séparation entre les extrémités des neurones ! À la place, on observe à chaque fois une continuité qui laisse la porte ouverte au syncytium. Depuis Cajal, ces mêmes schémas comportent des « blancs ». Désormais, les neurones sont bien des entités distinctes qui se touchent, qui communiquent, qui échangent des signaux chimiques... mais des entités distinctes ! Pour schématiser, Cajal utilisa une méthode géniale de coloration des neurones inventée par Golgi, pour démontrer qu'il avait raison et que Golgi avait tort ! Et ils furent tous les deux récompensés par le Prix Nobel en 1906 : Golgi pour la méthode de coloration argentique, et Cajal pour la théorie du neurone.
Qu'à changé cette théorie ?

Étudier les bases cérébrales et les neurosciences de la mémoire va révolutionner la définition initiale que nous avions de cette fonction.
Les années 1980 marquent un nouveau changement... Dès les années 1980, certains psychologues cognitivistes, comme Michael Posner, ont eu l'idée de célébrer les noces de la psychologie cognitive et de la théorie du neurone en partant d'une idée simple et puissante : si la vie mentale peut être décrite comme des processus de traitement de l'information, alors nous devrions être capables de décrire la biologie de ces processus, puisque le cerveau lui-même peut être décrit, depuis la naissance de la théorie du neurone, comme l'organe par excellence du traitement de l'information. L'activité de nos 80 milliards de neurones individuels peut coder les représentations mentales complexes qui définissent notre vie mentale. Ainsi apparurent les neurosciences cognitives.
On notera au passage que la psychologie cognitive n'est pas nécessairement associée à l'étude du cerveau. Cela peut sembler aujourd'hui étonnant, mais, au début de ma carrière, je rencontrais parfois des psychologues cognitivistes qui ne s'intéressaient pas du tout au cerveau. Ils étaient fonctionnalistes, essentiellement intéressés par le développement de la psychologie, sans chercher à l'articuler avec la biologie du cerveau. En réalité, c'est une approche qui a des limites... et c'est pour cela qu'il me semble important d'expliquer « pourquoi le cerveau », c'est-à-dire, quel est l'intérêt d'aller étudier les aspects moléculaires ou neurobiologiques pour répondre à ces questions sur le fonctionnement de notre psychisme...
Et d'ailleurs... pourquoi le cerveau ?

Considérons la mémoire. De prime abord, on pourrait penser que cette question psychologique n'a aucun besoin, pour être résolue, de faire appel au cerveau. En effet, étudier les bases cérébrales de la mémoire semble conduire dans le meilleur des cas à l'obtention d'une cartographie cérébrale de la mémoire, nous indiquant les lieux du cerveau impliqués dans la capacité à enregistrer, à stocker et à rappeler des expériences vécues. En réalité, non seulement les neurosciences de la mémoire vont effectivement permettre de produire cette fameuse cartographie, mais, et c'est ici que cela devient vertigineux, l'analyse de cette cartographie va conduire à révolutionner la définition initiale que nous avions de la mémoire, c'est-à-dire du phénomène psychologique lui-même. In fine, c'est la psychologie elle-même qui est enrichie par ce détour par les neurosciences.
La nuit, notre GPS cérébral se rallume
L'étude scientifique de la mémoire illustre bien cette conversation de longue date entre neurologie et psychologie...
Les neurosciences de la mémoire ont avancé grâce aux patients souffrant de problèmes de mémoire et, notamment, de ce qu'on appelle une amnésie antérograde, c'est-à-dire la difficulté à créer de nouveaux souvenirs. Dès les années 1950, on a remarqué que les patients dont les hippocampes sont sévèrement endommagés, voire détruits, perdaient de manière radicale leur capacité à créer de nouveaux souvenirs conscients des épisodes de leur vie. Voilà pour l'aspect cartographique de la mémoire : certains lieux du cerveau, dont les hippocampes, semblent impliqués de manière déterminante dans cette fonction mentale. Mais, au-delà de ce résultat cartographique, on a rapidement découvert que ces mêmes malades demeuraient parfaitement capables d'acquérir d'autres informations ainsi que d'autres apprentissages ! Autrement dit, si la mémoire consciente des épisodes de leur vie était sévèrement touchée, d'autres formes de mémoire fonctionnaient normalement chez eux. Et que ces autres formes de mémoire ne dépendaient pas des hippocampes, mais d'autres lieux du cerveau. Cela nous a ainsi conduits à formuler la théorie des systèmes de mémoire.
Un individu n'a donc pas une seule, mais plusieurs mémoires ?
En effet, on est passé d'une conception monolithique de « la » mémoire au singulier à une conception plurielle de la mémoire, qui est désormais envisagée comme une collection d'une douzaine de formes psychologiques différentes relativement indépendantes les unes des autres. Suite à cette révolution conceptuelle, la théorie des systèmes de mémoire a été formulée au cours des années 1980. Depuis, on sait que le « je me souviens » qui nous est si cher, et que l'on appelle désormais la mémoire épisodique consciente, ne constitue que l'un des nombreux systèmes de mémoire différente... C'est un premier exemple de ce que j'appelle une boucle dialectique : on part d'une définition psychologique, on la projette sur le cerveau, et au final notre définition initiale est transformée. Mais les sciences de la mémoire ne se sont pas arrêtées là !
En parallèle à ce chamboulement théorique, on a découvert dans les années 1970 que l'hippocampe, qui joue un rôle crucial pour la mémoire épisodique, était également impliqué dans une autre fonction mentale a priori très différente : la localisation dans l'espace. Concrètement, cela signifie qu'il existe des liens intimes qui unissent la mémoire épisodique, c'est-à-dire nos souvenirs, à la mémoire des lieux dans lesquels nous vivons et nous déambulons. C'est ce que j'appelle la double vie de l'hippocampe.
Racontez-nous cette découverte !
Tout commence chez le rat au cours des années 1970, quand John O'Keefe découvre ce que l'on appelle désormais des neurones de lieux (place cells) qui codent la position du lieu dans lequel il se trouve. Ce véritable GPS cérébral existe aussi chez l'homme et une découverte majeure, réalisée au cours des années 1990 presque par hasard (on parle de sérendipité, cet art de découvrir quelque chose de fondamental alors qu'on ne le cherchait pas), a transformé notre compréhension de son fonctionnement.
La nuit, lorsque nous gagnons les périodes du sommeil profond, notre GPS cérébral se « rallume », et rejoue des centaines, voire des milliers de fois les trajectoires empruntées la veille. Ce « replay » joue un rôle fondamental, non seulement pour nous souvenir des trajectoires effectuées, mais surtout pour consolider notre souvenir des épisodes vécus lorsque nous avons parcouru ces lieux. Autrement dit, la mémoire épisodique consciente emprunte un canal spatial et dépend de notre capacité à nous orienter dans les lieux dans lesquels nous vivons. En 2014, le Prix Nobel de médecine a été remis à John O'Keefe et au couple Moser pour leurs découvertes sur ce GPS cérébral... et souvenez-vous qui a reçu cette année-là le Prix Nobel de littérature : Patrick Modiano dont on peut très légitimement affirmer qu'il est l'écrivain de la double vie de l'hippocampe ! C'est-à-dire l'écrivain à la fois de la mémoire des individus – ce qui ne lui est pas spécifique –, mais surtout l'écrivain des liens intimes et indissociables qui unissent cette mémoire épisodique et la description des lieux des trajectoires empruntées par ses personnages lorsqu'ils ont vécu ce dont ils se souviendront.
De la théorie à la pratique, cette très grande découverte permet également d'offrir une base biologique à une méthode de mémorisation connue depuis l'Antiquité : la méthode des lieux, ou méthode des palais de mémoire. Si vous cherchez à mémoriser un texte très long, une astuce consiste à établir un lien entre ce texte et une promenade dans un lieu qui vous est extrêmement familier. Par exemple, parcourir une rue de votre ville dont vous connaissez chaque enseigne, chaque boutique, chaque croisement... Il suffit alors de vous imaginer vous promener dans cette rue et de déposer à chaque endroit un bout du texte en question pour faciliter grandement votre mémorisation du texte. Cette recette, déjà décrite par Cicéron, s'explique aujourd'hui scientifiquement par la démonstration de ce lien très fort qui existe entre l'orientation dans les lieux et la création de nouveaux souvenirs épisodiques.
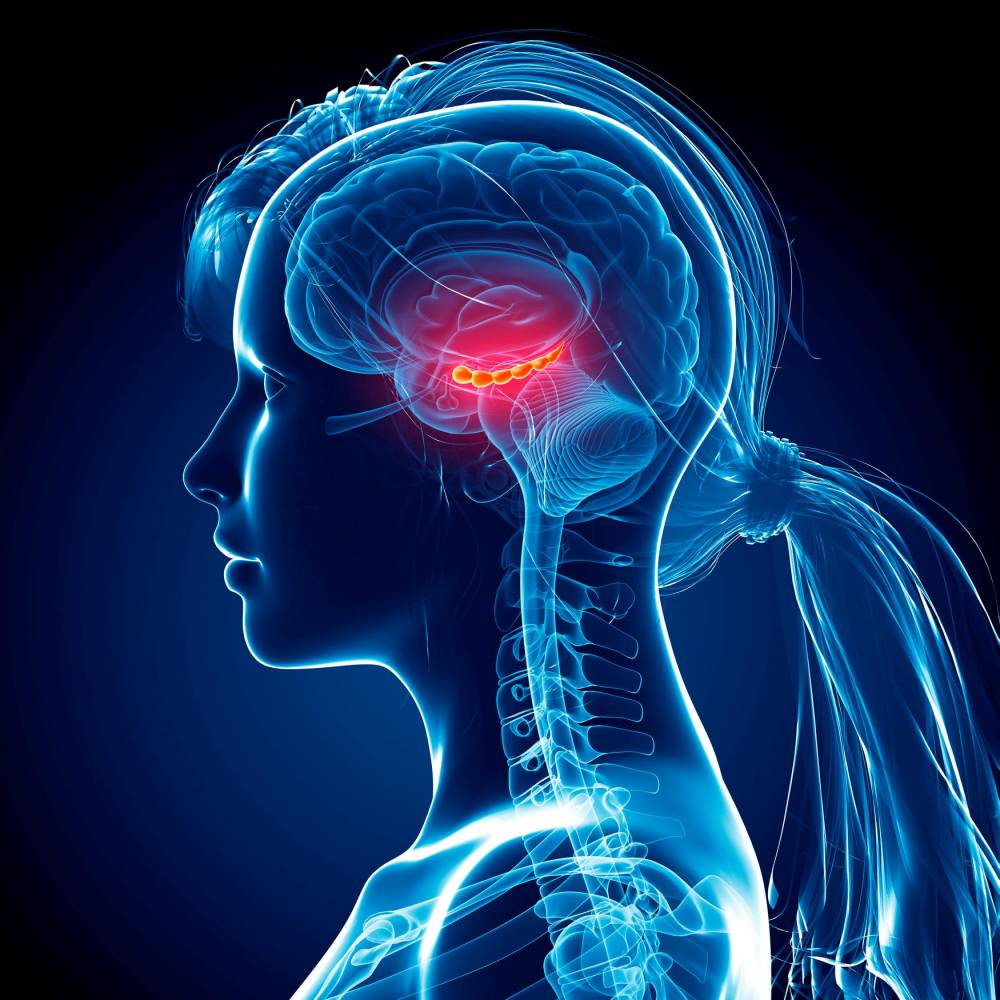
La mémoire est désormais envisagée comme une collection d'une douzaine de formes psychologiques différentes relativement indépendantes les unes des autres.
La connaissance de la structure et du fonctionnement du cerveau à tous ses niveaux d'organisation a donc explosé au XXe siècle. Quelles sont les grandes découvertes qui ont jalonné le terrain ?
En dehors de la théorie de neurones, que j'ai déjà évoquée, une autre grande étape est celle de la théorisation du concept de plasticité cérébrale par les travaux Donald Hebb, il y a plus d'un demi-siècle. Dès 1949, son intuition était que si deux neurones sont actifs en même temps, alors les synapses entre ces neurones seraient renforcées : « Neurons that fire together, wire together. » Écrire les premières pages d'une théorie neuronale de la plasticité permet de créer un cadre dans lequel la transformation de notre identité, de nos connaissances, trouve une assise biologique. À la suite de Hebb, de nombreux neurobiologistes ont réalisé les expériences qui ont confirmé et enrichi cette théorie de la plasticité des systèmes nerveux. Parmi eux, on peut citer Eric Kandel et ses travaux sur les bases moléculaires et cellulaires de différentes formes de mémoire qui démontrent la réalité de la plasticité cérébrale.
Aujourd'hui, on désigne par plasticité cérébrale cette capacité du cerveau à être transformé, jusque dans sa structure même, par nos apprentissages. D'une façon plus générale, toute l'architecture des réseaux de neurones est modifiée par notre expérience, par ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qu'a révélé une étude devenue célèbre sur le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens. Sachant qu'une structure de notre cerveau appelée l'hippocampe est nécessaire, tant pour la mémoire à long terme que la navigation spatiale, la neuroscientifique Eleanor Maguire de l'University College London a eu l'idée d'étudier le GPS cérébral, lové dans les hippocampes, du cerveau des chauffeurs de taxi pour déterminer s'ils étaient différents dans leur structure de ceux de volontaires du même âge, du même sexe et du même niveau d'étude : leur expertise de navigation et de mémorisation spatiale (avant la généralisation des GPS électroniques) allait-elle se voir sur une IRM cérébrale ? Elle a montré que la densité de substance grise des GPS était plus importante chez les chauffeurs de taxi que chez leurs alter ego non experts de la navigation spatiale. Ce résultat, parmi tant d'autres, illustre la plasticité cérébrale d'une manière éclairante.
C'est en étudiant des patients amnésiques que l'on a découvert l'existence de plusieurs formes de mémoire
Une autre découverte majeure a valu le Prix Nobel de médecine en 1981, le neurophysiologiste Roger Sperry, pour quels travaux ?
Ceux sur la spécialisation des aires cérébrales. Ses recherches portaient notamment sur l'étude de certains patients épileptiques ayant subi une section du corps calleux, cette partie du cerveau qui permet aux deux hémisphères de communiquer entre eux. Lorsque le corps calleux est endommagé ou absent, cette communication devient impossible. En testant ces patients, dont les deux hémisphères ne peuvent donc plus échanger des informations, Sperry se rend compte qu'ils sont incapables (surtout les droitiers) de nommer un objet présenté dans le champ visuel gauche qui est analysé par l'hémisphère droit. Ils réussissent à le reconnaître par la suite, mais ne peuvent lui attribuer un nom. À l'inverse, quand on leur présente le même objet dans le champ visuel droit, qui est lui analysé par l'hémisphère gauche, ils le dénomment sans aucun souci. Il en déduit donc que l'hémisphère gauche semble être spécialisé dans certaines fonctions du langage (comme, ici, la dénomination), alors que l'hémisphère droit ne dispose pas des mêmes compétences langagières. Aujourd'hui, l'idée que toutes les régions du cerveau ne font pas la même chose est devenue une évidence, pourtant, c'était très difficile à démontrer. Il ne faut pas imaginer ces régions comme des lieux isolés, mais comme des réseaux spécialisés composés de plusieurs régions distinctes et spécialisées.
Comme souvent, en neurosciences, c'est l'étude des malades qui a permis de faire progresser la connaissance fondamentale sur le fonctionnement du cerveau...
L'étude des patients est une source de connaissances très importante depuis toujours, pas uniquement pour la compréhension des maladies, mais également pour celle du fonctionnement du cerveau en général. L'étude des patients nous met sous les yeux ce que l'on n'a pas vu chez les sujets sains et cela nous permet d'analyser les mécanismes de façon beaucoup plus fine. C'est en étudiant des patients amnésiques que l'on a découvert l'existence de plusieurs formes de mémoire… La neurologie continue de progresser ainsi. L'étude fine des malades n'est pas une période révolue dans l'histoire des neurosciences, avant que l'on dispose d'outils performants comme l'IRM et le scanner. L'étude des malades en 2019 reste une voie d'exploration tout à fait privilégiée pour comprendre le cerveau et c'est aussi pour cela qu'il est intéressant de faire des aller-retour entre la neurologie et la recherche. Je travaille sur la conscience et, par exemple, le fait de découvrir qu'un malade peut être éveillé sans être conscient (comme durant certaines crises d'épilepsie, ou plus tragiquement lors d'un état qualifié de végétatif) transforme notre compréhension de ce qu'est la conscience et de ses bases cérébrales.
Faire le pont entre clinique et recherche, c'est concrètement au cœur de votre activité, puisque vous êtes neurologue à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM)... Comment conciliez-vous ces deux métiers ?
Pour moi, avoir un pied de chaque côté est à la fois compliqué et très riche. Le plus difficile, au quotidien, est de jongler entre deux échelles de temps très différentes. À l'hôpital, on est dans le temps du malade et il faut savoir poser un diagnostic, prendre des décisions thérapeutiques à la lumière des connaissances actuelles, tout en apportant au patient son soutien et en étant sensible à ses questionnements, à ses préoccupations, à ses requêtes. On est absorbé dans cette immédiateté. Il ne s'agit pas, ici, de se livrer à un exercice reposant sur le doute et sur la remise en cause de nos idées reçues, telles qu'on essaie de le faire au laboratoire et avec sa casquette de chercheur. Le chercheur, lui, peut passer plusieurs mois, voire plusieurs années, sur son sujet d'étude sans savoir s'il va dans la bonne direction, ce n'est pas du tout la même temporalité. Donc, le fait d'avoir les deux est une source d'équilibre. Mais, surtout, cela permet de mener des projets de recherche qui sont au croisement des deux et c'est, notamment, ce que nous faisons à l'ICM qui est un centre de recherches implanté au cœur de l'hôpital.
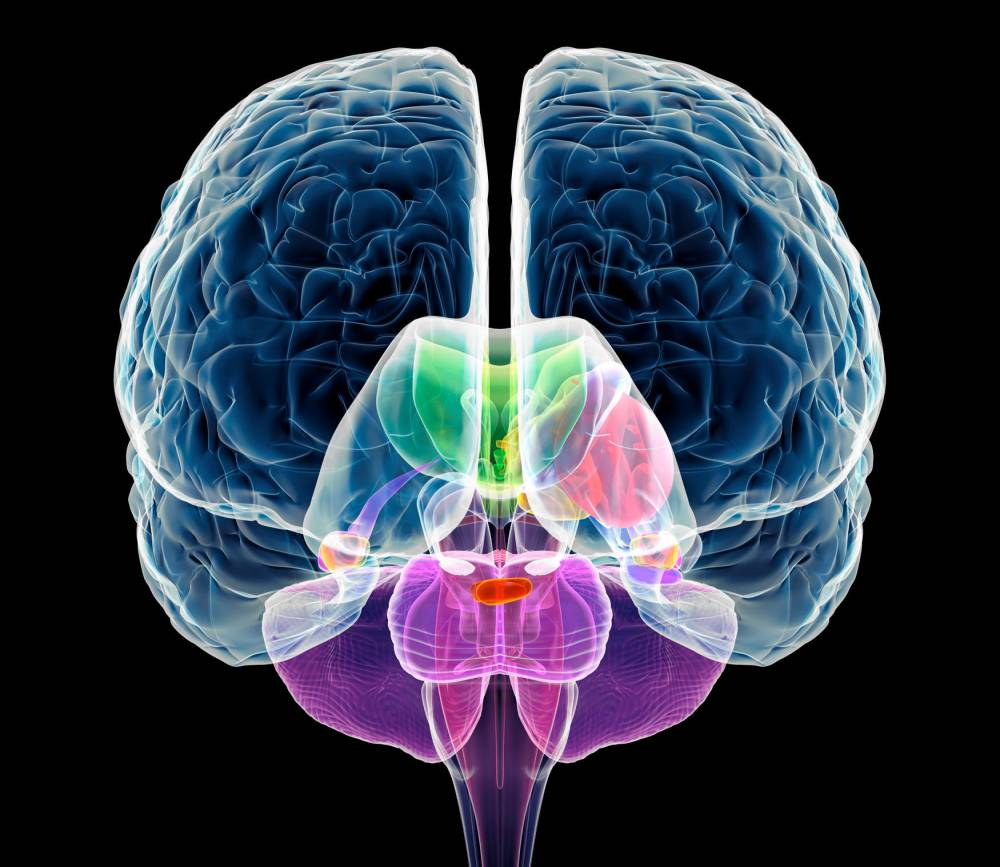
Aujourd'hui, l'idée que toutes les régions du cerveau ne font pas la même chose est devenue une évidence, pourtant, c'était très difficile de le démontrer.
Quelle est, à l'origine de votre vocation, la grande question à laquelle vous cherchez à répondre ?
Ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est d'explorer et de comprendre les ressorts de la subjectivité humaine. Et, en écho à la démarche dialectique que je mentionnais plus haut, je pense que l'étude des maladies du cerveau permet de nous éclairer quant à cette question existentielle : qui suis-je ? Qui suis-je à mes propres yeux ? Comment suis-je capable de penser et de croire ce que je pense et ce que je crois ? Une science de la subjectivité doit évidemment faire usage des neurosciences cognitives pour progresser. En médecine, pour répondre à ces questions sur la subjectivité, il me semblait qu'il y a avait deux grandes disciplines, la neurologie et la psychiatrie. J'ai choisi la neurologie parce qu'elle relie de façon très fine le discours subjectif du malade avec un examen du corps, de ses réflexes, bref, une observation objective du fonctionnement de son système nerveux. C'est cette union qui fait que l'on est dans une certaine forme de science clinique de la subjectivité... Rappelons que, jusqu'en 1968, psychiatrie et neurologie ne formaient qu'une seule discipline. Puis, elles ont été séparées. Mais aujourd'hui, on est en train de reformuler une nouvelle neuropsychiatrie, où les deux cultures se rejoignent.
Sait-on aujourd'hui déterminer si un individu incapable de communiquer est conscient ou non ?
C'est une question qui est au cœur de mes recherches, à laquelle je me suis beaucoup consacré. Que se passe-t-il dans le cerveau quand l'individu prend conscience de quelque chose ? La perception d'une information se fait toujours en deux phases : dans un premier temps, elle est inconsciente. Puis, c'est une sorte de conversation entre les régions antérieures et postérieures du cerveau qui mène à la prise de conscience. Dans notre laboratoire et dans celui de Stanislas Dehaene , avec des IRM fonctionnelles et des EEG, notre recherche consiste à détecter et à mesurer les briques de cette conversation. Objectif : trouver des « marqueurs » de l'état de conscience, mais aussi améliorer la situation des patients souffrant d'un état déficitaire de la conscience... En 2009, nous avons mis au point avec Tristan Bekinschtein un test auditif qui permet d'évaluer l'état de conscience d'une personne en séparant les étapes cérébrales de traitement inconscient des sons, de celle qui signe la prise de conscience de leur présence. Ce test est désormais utilisé dans plusieurs centres à travers le monde.
Aujourd'hui, on a donc beaucoup avancé sur la découverte de ces « signatures cérébrales » qui permettent de déterminer, quand on regarde un cerveau à l'imagerie, s'il fonctionne en mode conscient ou non. L'analyse de ces résultats impose tout d'abord de se mettre d'accord sur les mots, c'est-à-dire de commencer par définir ce que l'on entend par conscience.
Il faut trouver des « marqueurs » de l'état de conscience
Mais alors, quelle est la définition la plus opérationnelle de la conscience, d'un point de vue scientifique ?
L'une des propriétés fondamentales de la conscience, me semble-t-il, peut-être décrite par le néologisme de « rapportabilité ». Être conscient, c'est être capable de se rapporter à soi-même certains de nos états mentaux, comme lorsque l'on se dit : je suis en train de lire le mot conscience ; j'entends X ; je me souviens d'Y ; je ressens une émotion Z ; je suis en train de faire telle action... Cette définition réflexive de la conscience revient à postuler qu'être conscient, c'est donc être capable de se rapporter subjectivement quelque chose. Et c'est cette subjectivité qu'on essaie d'appréhender scientifiquement avec des méthodes objectives. On peut ainsi utiliser la boîte à outils des neurosciences afin de déterminer les conditions cérébrales qui doivent être réunies pour qu'un sujet soit conscient. C'est ainsi qu'à travers de nombreuses expériences nous avons découvert que, chaque fois que nous sommes dans un état conscient, notre cerveau fonctionne d'une manière spécifique et mesurable : des régions distantes et intelligentes de notre cerveau entrent – sans chauvinisme aucun –, dans une sorte de « conversation à la française ». Une conversation cérébrale qui se déroule ainsi à l'échelle de notre vaste cerveau, une conversation complexe, différentiée et qui utilise certaines bandes de fréquences des oscillations de nos réseaux de neurones. On peut aujourd'hui l'identifier avec des outils tels que l'EEG.
Vous avez proposé à la rédaction du Point de structurer ce hors-série autour des nouvelles frontières du cerveau. À quoi font-elles référence ? Qu'entendez-vous par la notion de frontière ?
Repousser les frontières d'un savoir, c'est aller au-delà du territoire qui constitue le noyau central d'une recherche. En explorant un phénomène, non pas dans la zone de confort de nos connaissances, on commence par explorer les situations les moins complexes. Si je compare l'activité de votre cerveau lorsque vous êtes profondément inconscient lors de périodes de sommeil profond, avec celle qui est présente alors que vous êtes bien éveillé et conscient – comme lorsque vous lisez cette page –, il est assez facile d'identifier de grandes signatures cérébrales de l'état de conscience, que l'on peut mesurer, par exemple, avec un électroencéphalogramme ou une IRM fonctionnelle. Mais une fois que l'on dispose de ces fameuses signatures, il est intéressant d'explorer la question de la conscience aux frontières de notre connaissance : allons-nous retrouver ces fameuses signatures chez un bébé ? Chez un malade non communicant dont on ne sait pas s'il est conscient ou pas ? Chez les primates non humains ou dans d'autres espèces animales ? Et si, d'aventure, ces signatures sont présentes, comment cela va-t-il modifier notre définition même de la conscience qui a été posée dans une situation très restreinte : celle d'un adulte éduqué, socialisé, maîtrisant le langage ?

La perception d'une information se fait toujours en deux phases : dans un premier temps, elle est inconsciente. Puis, c'est une sorte de conversation entre les régions antérieures et postérieures du cerveau qui mène à la prise de conscience.
L'une de ces explorations frontalières est d'aller vers le cerveau des tout-petits... que nous révèlent les neurosciences sur le fonctionnement cognitif des bébés ?
Loin d'être une tabula rasa vierge de toute connaissance, l'esprit du bébé (donc aussi son cerveau) est déjà riche d'une foule de compétences cognitives et neuronales de haut niveau, prêtes à s'affiner en fonction de ses expériences et de ses apprentissages. Sur le plan du langage les études en IRM fonctionnelle ont dévoilé que, dès les premiers mois de vie, les cerveaux des bébés montrent une spécialisation dans l'écoute du langage qui engage déjà les réseaux cérébraux spécialisés que l'on connaissait chez l'adulte, notamment dans l'hémisphère gauche. Sur le plan psycho linguistique, on sait depuis les années 1970 qu'à la naissance un bébé humain est capable de distinguer l'ensemble des phonèmes qui composent les différentes langues humaines. Puis, progressivement, il va renforcer sa maîtrise des phonèmes (les sons élémentaires du langage qui composent les syllabes) auxquels il est exposé dans son environnement et il va perdre sa capacité à traiter des phonèmes auxquels il n'est jamais exposé. Le langage, donc, mais également l'attention, la cognition sociale, et même la conscience se développent extrêmement tôt et on commence à pouvoir identifier les grandes étapes de ce développement cognitif qui participe à la constitution de l'identité subjective de l'individu.
Ce qui est fascinant avec le bébé c'est que, plutôt que de recevoir passivement des informations du monde extérieur, il est engagé de manière très proactive dans des apprentissages nécessaires à son développement. On le voit notamment à travers des phénomènes comme l'attention conjointe, qui permet d'apprendre à faire attention à certains objets via des échanges de regards entre l'adulte, le bébé et l'objet concerné. Cela confirme qu'un cerveau isolé ne fait rien, mais qu'il évolue en permanence en interaction avec son environnement et au contact de ses semblables.
Nos vieux cerveaux ont bien intégré « l'effet Google »
Cette interaction avec l'autre constitue-t-elle l'une des nouvelles frontières de notre connaissance, celles des liens entre le cerveau et le monde qui l'entoure ?
J'aime bien dire que le cerveau dans un bocal ne sert à rien : c'est en interagissant avec un corps et avec son environnement qu'il devient l'organe biologique de notre subjectivité. Le cerveau d'un individu appartient à un corps (nos autres organes) avec lequel il ne cesse d'interagir, et il se situe dans un corps social dès sa naissance et même avant. Un corps social où les échanges avec autrui, l'exposition à des langues, une culture, une civilisation et une histoire vont jouer un rôle déterminant dans l'émergence de fonctions mentales. Sans interaction sociale précoce, pas d'apprentissage du langage...
Dans L'homme réseau-nable, vous compariez le fonctionnement de notre société au microcosme de notre cerveau. Alors que nous sommes en interaction permanente avec les technologies numériques, cela change-t-il notre façon de penser ? Notre cerveau s'est-il adapté aux outils qu'il a lui-même créés ?
En réalité, à l'échelle de l'évolution dont les constantes de temps sont le plus souvent de l'ordre de centaines, voire de millions d'années, notre cerveau d'homo sapiens n'a pas eu le temps d'évoluer de manière substantielle sur le plan génétique au cours des 6 000 années qui viennent de s'écouler. Nous avons pourtant, durant ce bref clin d'œil, quitté la Préhistoire, inventé l'écriture et la lecture, et de nombreuses autres technologies de communication, qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes. Ce faisant, nos vieux cerveaux ont su s'adapter à un environnement pour lequel ils n'étaient pas conçus génétiquement. Un bébé humain naît aujourd'hui avec le même cerveau qu'un bébé né à l'époque de Périclès. Comment nous adaptons-nous, alors, à cette fulgurante vague d'innovations ? Grâce à l'incroyable plasticité cérébrale que nous avons évoquée. La culture et l'ensemble de nos interactions sociales suscitent des modifications riches et permanentes de la structure fine et de l'activité de nos cerveaux. Ces modifications sont la traduction biologique de nos transformations psychologiques et de nos apprentissages les plus divers. Nos stratégies cognitives permettent, là encore, de « faire du neuf », et de s'adapter à ce neuf, avec notre vieux cerveau. À propos du futur de notre cerveau, j'aime bien citer une découverte intéressante de Betsy Sparrow, de l'université de Columbia, à New York. Dans une étude publiée dans Science, en 2011, elle a montré avec ses collègues que notre esprit a internalisé le concept de moteur de recherches, ce qu'elle appelle « l'effet Google » : face à une question difficile pour laquelle nous n'avons pas de réponse, nous activons mentalement, à notre insu, les concepts des moteurs de recherche usuels (Yahoo, Google...). Cette stratégie cognitive est une évolution culturelle.
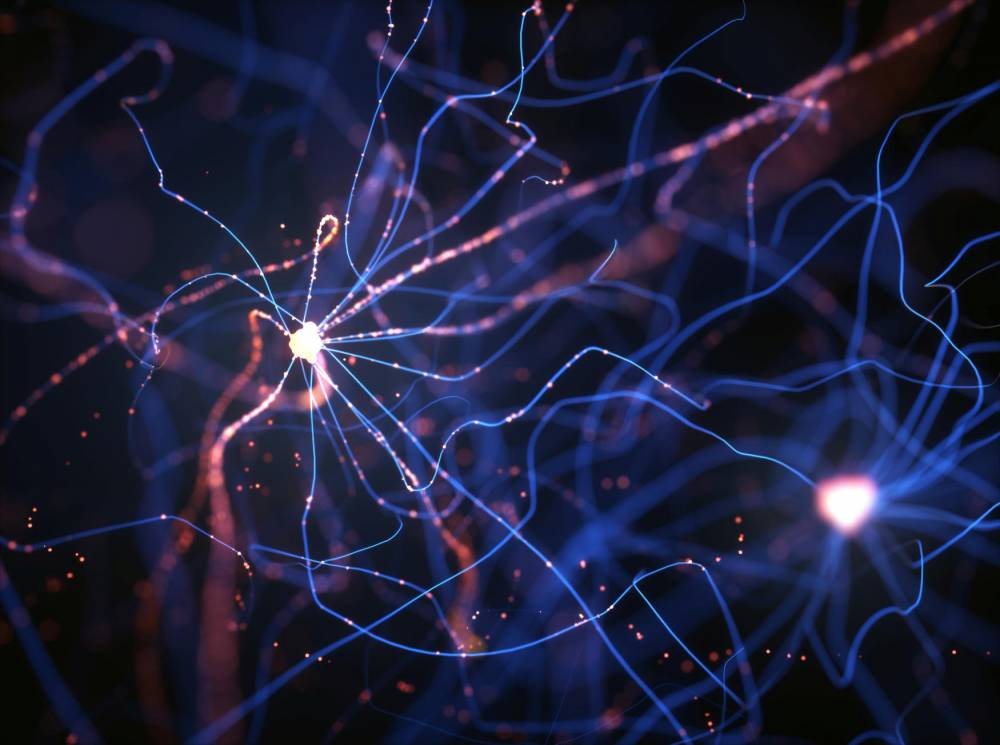
On a découvert, il y a une dizaine d'années, que les cellules gliales participent directement au codage de l'information par les neurones, qu'elles peuvent libérer des neurostransmetteurs et qu'elles jouent un rôle de neuromodulation très subtil.
C'est vrai depuis des années, les cellules gliales par exemple se font piquer la vedette par les neurones, alors qu'elles sont 10 fois plus nombreuses dans notre cerveau ! Le premier véritable best-seller neuroscientifique de Jean-Pierre Changeux et publié en 1983, était d'ailleurs intitulé L'homme neuronal... Les cellules gliales constituent un peu la glue des neurones, et regroupent plusieurs types de cellules qui portent les noms d'astrocytes, de oligodendrocytes, ou encore de cellules microgliales... Et si on les a longtemps aussi peu considérées, c'est parce qu'on pensait que leur rôle ne se réduisait qu'à des fonctions de « ménagères » du cerveau, qu'elles étaient cantonnées à assurer des activités d'alimentation, de protection et de nettoyage des fameux neurones. Or les cellules gliales assurent effectivement ces fonctions, mais leur rôle va bien au-delà. On a ainsi découvert, il y a une dizaine d'années, qu'elles participent directement au codage de l'information par les neurones, qu'elles peuvent libérer des neurotransmetteurs et qu'elles jouent en réalité un rôle de neuromodulation très subtil.
L'année dernière, Yves Agid et Pierre Magistretti ont signé un livre intitulé « Homme glial » (Éditions Odile Jacob), en écho à L'Homme neuronal, de Jean-Pierre Changeux, pour mettre en avant cette « autre moitié du cerveau » longtemps restée dans l'ombre. La compréhension de ce rôle décisif des cellules gliales est une véritable révolution, qui ouvre de nouvelles pistes dans le traitement des maladies neuropsychiatriques. Autrement dit, comprendre véritablement le fonctionnement du cerveau impose de comprendre dans le détail le rôle joué par cette « matière noire » cérébrale et de poursuivre l'exploration de ces nouvelles frontières, au-delà des neurones...
Les neurosciences suscitent beaucoup d'espoirs, notamment dans le champ des maladies du cerveau... concrètement, où en sont les progrès thérapeutiques ? Les patients bénéficient-ils de l'avancée des recherches ?
Bien sûr, il y a déjà certaines applications. On peut citer, par exemple, la technique révolutionnaire de neurostimulation utilisée pour la première fois en 1993 par Alim-Louis Benabid et Pierre Pollak sur la maladie de Parkinson. Grâce à la mise en place chirurgicale d'électrodes dans une zone profonde du cerveau, le noyau subthalamique, des impulsions électriques sont émises de façon très ciblée et certains symptômes de la maladie de Parkinson sont nettement corrigés. Mais, le plus souvent, de la recherche fondamentale à la clinique, les choses ne se déroulent pas de façon linéaire, car il y a des cassures, des changements de paradigmes, sur un temps assez long… Concernant les grands défis, aujourd'hui, que sont les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou sur le plan psychiatrique, la schizophrénie, l'autisme, les connaissances augmentent, mais il faut dire que nous sommes encore en très grande attente. On comprend mieux les mécanismes des maladies, mais on ne sait pas encore utiliser ces connaissances pour guérir les malades qui en souffrent. Aujourd'hui il y a eu une révolution conceptuelle en neurosciences, mais la révolution thérapeutique en neurologie et en psychiatrie est encore à venir. C'est aussi une frontière qu'il faut surveiller, et que l'on espère déplacer...
Interview by Lucie Sarfaty
A graduate of the École normale supérieure, Lionel Naccache is a neurologist, professor of physiology at Sorbonne University and hospital practitioner at La Pitié-Salpêtrière in Paris. This specialist in cognitive neuroscience, a researcher at the Institute of Brain and Spinal Cord (ICM), has been a member of the National Ethics Committee since 2013.
His work is devoted to the exploration of the psychological properties and brain bases of consciousness. They combine several complementary approaches, including the clinical experience of patients with neurological or psychiatric disorders, as well as the study of cognition in healthy and sick men using experimental paradigms of cognitive psychology combined with functional brain imaging techniques. Author of numerous successful essays (Le Nouvel Inconscient, L'Homme réseau-nable or Le Chant du signe), he wrote his latest book (Parlez-vous cerveau ? Odile Jacob, 2018) with his wife Karine.
Does the enthusiasm for scientific news about how our brains work correspond to a real revolution in research?
Lionel Naccache: Indeed, we can say that neuroscience has been undergoing a revolution for about forty years, and that society has been aware of it for about fifteen years. This revolution has mainly affected a branch of neuroscience called cognitive neuroscience. Neuroscience is the science of the nervous system. The neuroscience subbranch, which aims to explore the biology of thought, mental life in general, emotions and behaviours, is called cognitive neuroscience. My own work is part of it, essentially around the exploration of consciousness, therefore, also of unconscious or unconscious cognitive processes.
Our 80 billion neurons are separate entities.
How did cognitive neuroscience, as we know it, emerge?
It is a union between two different scientific fields: on the one hand, the theory of the neuron that was born in the 20th century and, on the other hand, cognitive psychology that appeared in the 1950s. This union between neural theory and cognitive psychology occurred in the 1980s. Let's start again. It was not until the 1900s that it was understood that neurons are the basic structural and functional units of the nervous system, thanks to the work of the Spanish doctor and neuroscientist Santiago Ramón y Cajal. Before him, the question remained unclear. Some scientists, including Camillo Golgi, believed that neurons in contact with each other fused together to form large and large cells: what is called syncytium. On the other hand, Ramón y Cajal developed a kind of individualistic conception of neurons: each neuron is isolated from the others by its membrane and the contact points between adjacent neurons (synapses) respect these cellular individualities. It is quite interesting to reread the magnificent schematics of the neuroanatomists and neuro-histologists before Cajal: we can see complex neural circuits, but something is missing: the separation between the ends of the neurons! Instead, there is always continuity that leaves the door open to syncytium. Since Cajal, these same schemes have included "blanks". From now on, neurons are distinct entities that touch, communicate, exchange chemical signals... but distinct entities! To summarize, Cajal used a brilliant method of neural staining invented by Golgi, to prove that he was right and that Golgi was wrong! And they were both awarded the Nobel Prize in 1906: Golgi for the silver colouring method, and Cajal for neuron theory.
What has changed this theory?
By highlighting that neurons are separate cellular entities, Cajal radically changed the way we look at the brain, because once we understood that a neuron could be in two main states of activity (rest or action potential), it appeared that each of them can therefore code two pieces of information (a bit like bits in information theory: 0 or 1). Imagine very schematically a nervous system that would be composed of two neurons: if each of them can code two pieces of information, then this small virtual brain with two neurons could already code 2 x 2 = 4, thanks to Cajal's neuronal individualism. With Golgi, these two neurons that form only one neuron could only code for two states, since they are not actually separate entities. Now jump to our brain, which is composed of 80 billion neurons. The theory of the neuron has allowed us to conceive that it can therefore theoretically code for two, power 80 billion, different states, different information. So much for the neuron theory. After the Second World War, cognitive psychology was born from an idea: and if mental life could be described using an informational metaphor. After using mechanical, reflex or thermodynamic metaphors, a new approach was born. It is therefore a question of describing thought, emotions, learning, knowledge using information theory.
The 1980s marked a new change.... As early as the 1980s, some cognitive psychologists, such as Michael Posner, had the idea of celebrating the marriage of cognitive psychology and neuron theory from a simple and powerful perspective: if mental life can be described as information processing processes, then we should be able to describe the biology of these processes, since the brain itself can be described, since the birth of neuron theory, as the organ par excellence in information processing. The activity of our 80 billion individual neurons can code the complex mental representations that define our mental life. This is how cognitive neuroscience appeared.
It should be noted in passing that cognitive psychology is not necessarily associated with the study of the brain. This may seem surprising today, but at the beginning of my career, I sometimes met cognitive psychologists who were not at all interested in the brain. They were functionalists, essentially interested in the development of psychology, without seeking to articulate it with the biology of the brain. In reality, it is an approach that has limits... and that is why it seems important to me to explain "why the brain", that is, what is the interest of studying the molecular or neurobiological aspects to answer these questions about the functioning of our psyche...
And by the way... why the brain?
The scientific challenge is to understand the psychological properties and brain mechanisms of the most varied mental functions: perception, memory, language, reasoning, beliefs, consciousness, imagination... Like most researchers in cognitive neuroscience, my research activity is similar to that of a psychologist who uses neuroscience as a toolbox, rather than as an end in itself. The idea I defend is that this toolbox is an incredible source of knowledge for the psychologist, just as the study of behaviour is another, which has been used for more than a century. Why? Why? Essentially because I think that better "mapping" the brain sites and the temporality of our mental functions means revolutionizing the way we represented these functions, because of the unique properties of these places that are associated with them. I will explain myself by an example.
Let's consider memory. At first glance, one might think that this psychological question does not need to be resolved by using the brain. Indeed, studying the brain bases of memory seems to lead at best to a brain mapping of memory, indicating the places in the brain involved in the ability to record, store and recall lived experiences. In reality, not only will the neurosciences of memory make it possible to produce this famous cartography, but, and this is where it becomes dizzying, the analysis of this cartography will lead to a revolution in the initial definition we had of memory, that is, of the psychological phenomenon itself. In the end, it is psychology itself that is enriched by this detour into neuroscience.
At night, our brain GPS turns back on.
The scientific study of memory illustrates this long-standing conversation between neurology and psychology...
Memory neuroscience has advanced thanks to patients with memory problems, including so-called anterograde amnesia, the difficulty of creating new memories. As early as the 1950s, it was noted that patients whose seahorses were severely damaged or even destroyed lost their ability to create new memories of life episodes. So much for the cartographic aspect of memory: certain places in the brain, including seahorses, seem to be decisively involved in this mental function. But beyond this mapping result, it was quickly discovered that these same patients were still perfectly capable of acquiring other information and learning! In other words, if the conscious memory of episodes in their lives was severely affected, other forms of memory were functioning normally in them. And that these other forms of memory did not depend on seahorses, but on other parts of the brain. This led us to formulate the theory of memory systems.
So an individual does not have only one, but several memories?
Indeed, we have moved from a monolithic conception of "memory" in the singular to a plural conception of memory, which is now considered as a collection of a dozen different psychological forms relatively independent of each other. As a result of this conceptual revolution, the theory of memory systems was formulated in the 1980s. Since then, we know that the "I remember" that is so dear to us, and that is now called conscious episodic memory, is only one of many different memory systems... This is a first example of what I call a dialectical loop: we start from a psychological definition, project it onto the brain, and ultimately our initial definition is transformed. But the sciences of memory did not stop there!
In parallel to this theoretical upheaval, it was discovered in the 1970s that the hippocampus, which plays a crucial role for episodic memory, was also involved in another mental function that was a priori very different: localization in space. In concrete terms, this means that there are intimate links between episodic memory, that is, our memories, and the memory of the places in which we live and walk. This is what I call the double life of the hippocampus.
Tell us about this discovery!
At night, when we reach periods of deep sleep, our brain GPS "turns back on", and replays hundreds, even thousands of times the trajectories used the day before. This "replay" plays a fundamental role, not only to remember the trajectories made, but above all to consolidate our memory of the episodes experienced when we visited these places. In other words, conscious episodic memory follows a spatial channel and depends on our ability to orient ourselves in the places in which we live. In 2014, the Nobel Prize for Medicine was awarded to John O'Keefe and the Moser couple for their discoveries on this brain GPS... and remember who received the Nobel Prize for literature that year: Patrick Modiano who can legitimately be said to be the writer of the hippocampus' double life! That is to say, the writer both of the memory of individuals - which is not specific to him - but above all the writer of the intimate and inseparable links that unite this episodic memory and the description of the places of the trajectories followed by his characters when they have experienced what they will remember.
From theory to practice, this very great discovery also provides a biological basis for a method of memorization known since Antiquity: the method of places, or the method of memory palaces. If you are trying to memorize a very long text, a trick is to link it to a walk in a place that is extremely familiar to you. For example, walking down a street in your city where you know every sign, every shop, every intersection.... All you have to do is imagine walking down this street and leaving a piece of the text in question at each place to make it much easier for you to memorize the text. This recipe, already described by Cicero, is now scientifically explained by the demonstration of this very strong link between orientation in the place and the creation of new episodic memories.
Knowledge of the structure and functioning of the brain at all levels of organization has therefore exploded in the 20th century. What are the major discoveries that have marked the field?
Apart from the theory of neurons, which I have already mentioned, another major step is the theorization of the concept of brain plasticity by the work of Donald Hebb more than half a century ago. As early as 1949, his intuition was that if two neurons were active at the same time, then the synapses between these neurons would be strengthened: "Neurons that fire together, wire together. "Writing the first pages of a neural theory of plasticity creates a framework in which the transformation of our identity, of our knowledge, finds a biological basis. Following Hebb, many neurobiologists carried out experiments that confirmed and enriched this theory of plasticity of the nervous systems. Among them, we can mention Eric Kandel and his work on the molecular and cellular bases of different forms of memory that demonstrate the reality of brain plasticity.
Today, brain plasticity refers to the brain's ability to be transformed, even in its very structure, by our learning. More generally, the entire architecture of neural networks is modified by our experience, by what we are experiencing. This was revealed in a famous study on the brains of London taxi drivers. Knowing that a structure in our brain called the hippocampus is necessary, both for long-term memory and space navigation, neuroscientist Eleanor Maguire of University College London had the idea of studying the brain GPS, coiled in the hippocampuses, of taxi drivers' brains to determine if they were different in their structure from those of volunteers of the same age, sex and level of study: would their expertise in navigation and spatial memorization (before the generalization of electronic GPS) be seen on a brain MRI? It showed that the grey matter density of GPS was higher among taxi drivers than among their non-expert space navigation counterparts. This result, among many others, illustrates brain plasticity in an illuminating way.
It is by studying amnesiac patients that we discovered the existence of several forms of memory
Another major discovery won the Nobel Prize in Medicine in 1981, the neurophysiologist Roger Sperry, for which works?
Those on the specialization of brain areas. His research included the study of certain epileptic patients who have had a section of the corpus callosum, the part of the brain that allows the two hemispheres to communicate with each other. When the corpus callosum is damaged or absent, this communication becomes impossible. By testing these patients, whose information can no longer be exchanged between the two hemispheres, Sperry realizes that they are unable (especially right-handed people) to name an object presented in the left visual field that is analyzed by the right hemisphere. They succeed in recognizing it later on, but cannot give it a name. On the other hand, when the same object is presented to them in the right visual field, which is analyzed by the left hemisphere, they call it without any concern. He therefore concludes that the left hemisphere seems to be specialized in certain language functions (such as, in this case, the name), while the right hemisphere does not have the same language skills. Today, the idea that not all regions of the brain do the same thing has become obvious, yet it was very difficult to demonstrate. These regions should not be seen as isolated places, but as specialized networks composed of several distinct and specialized regions.
As is often the case in neuroscience, it is the study of patients that has made it possible to advance fundamental knowledge about how the brain works...
The study of patients has always been a very important source of knowledge, not only for the understanding of diseases, but also for the understanding of brain function in general. The study of patients brings to our attention what has not been seen in healthy subjects and this allows us to analyse the mechanisms much more precisely. It is by studying amnesiac patients that we discovered the existence of several forms of memory... Neurology continues to progress in this way. The detailed study of patients is not a thing of the past in the history of neuroscience, until powerful tools such as MRI and CT are available. The study of patients in 2019 remains a very privileged path of exploration to understand the brain and that is also why it is interesting to go back and forth between neurology and research. I work on consciousness and, for example, discovering that a patient can be awakened without being conscious (as during certain epileptic seizures, or more tragically during a state called vegetative) transforms our understanding of what consciousness is and its brain bases.
Bridging the gap between clinic and research is at the heart of your activity, since you are a neurologist at La Pitié-Salpêtrière Hospital and a neuroscientist at the Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM)... How do you reconcile these two professions?
For me, having one foot on each side is both complicated and very rich. The most difficult thing to do on a daily basis is to juggle two very different time scales. At the hospital, we are in the patient's time and we must know how to make a diagnosis, make therapeutic decisions in the light of current knowledge, while providing the patient with support and being sensitive to his or her questions, concerns and requests. We are absorbed in this immediacy. This is not an exercise based on doubt and questioning our preconceived ideas, as we are trying to do in the laboratory and with our researcher's cap. The researcher may spend several months, even several years, on his subject of study without knowing if he is going in the right direction, it is not at all the same temporality. So having both is a source of balance. But, above all, it makes it possible to carry out research projects that are at the crossroads of both, and this is what we do at the MHI, which is a research centre located in the heart of the hospital.
What is the origin of your vocation, the great question to which you seek to answer?
What has always interested me is to explore and understand the dynamics of human subjectivity. And, echoing the dialectical approach I mentioned above, I think that the study of brain diseases helps us to shed light on this existential question: who am I? Who am I to my own eyes? How am I able to think and believe what I think and believe? A science of subjectivity must obviously make use of cognitive neuroscience to progress. In medicine, to answer these questions about subjectivity, it seemed to me that there were two main disciplines, neurology and psychiatry. I chose neurology because it links in a very fine way the patient's subjective discourse with an examination of the body, its reflexes, in short, an objective observation of the functioning of its nervous system. It is this union that makes us in a certain form of clinical science of subjectivity.... It should be remembered that, until 1968, psychiatry and neurology were only one discipline. Then they were separated. But today, we are reformulating a new neuropsychiatry, where the two cultures meet.
Is it now possible to determine whether an individual unable to communicate is conscious or not?
This is an issue that is at the heart of my research, to which I have devoted a lot of time. What happens in the brain when the individual becomes aware of something? The perception of information is always done in two phases: at first, it is unconscious. Then, it is a kind of conversation between the anterior and posterior regions of the brain that leads to awareness. In our laboratory and in Stanislas Dehaene's, with functional MRIs and EEGs, our research consists in detecting and measuring the bricks of this conversation. Objective: to find "markers" of the state of consciousness, but also to improve the situation of patients suffering from a state of deficit of consciousness.... In 2009, we developed with Tristan Bekinschtein a hearing test that assesses a person's state of consciousness by separating the cerebral stages of unconscious sound processing from the one that signs the awareness of their presence. This test is now used in several centres around the world.
Today, we have made a lot of progress in discovering these "brain signatures" that make it possible to determine, when we look at a brain on imaging, whether it functions in conscious mode or not. The analysis of these results requires first of all to agree on the words, i.e. to begin by defining what is meant by consciousness.
We must find "markers" of the state of consciousness
But then, what is the most operational definition of consciousness, from a scientific point of view?
One of the fundamental properties of consciousness, it seems to me, can be described by the neologism of "rapportability". To be conscious is to be able to relate to yourself some of your mental states, as when you say to yourself: I am reading the word consciousness; I hear X; I remember Y; I feel an emotion Z; I am doing such an action... This reflexive definition of consciousness is like postulating that being conscious is therefore being able to relate something subjectively. And it is this subjectivity that we try to apprehend scientifically with objective methods. This allows the neuroscience toolbox to be used to determine the brain conditions that must be present for a subject to be conscious. Thus, through many experiences we have discovered that, every time we are in a conscious state, our brain functions in a specific and measurable way: distant and intelligent regions of our brain enter - without any chauvinism - into a kind of "French conversation". A brain conversation that takes place on the scale of our vast brain, a complex, differentiated conversation that uses certain frequency bands of the oscillations of our neural networks. It can now be identified with tools such as EEG.
You proposed to the editorial staff of the Point to structure this special edition around the new frontiers of the brain. What are they referring to? What do you mean by the notion of border?
Pushing the boundaries of knowledge means going beyond the territory that constitutes the central core of a research project. By exploring a phenomenon, not in the comfort zone of our knowledge, we begin by exploring the least complex situations. If I compare the activity of your brain when you are deeply unconscious during periods of deep sleep with the activity that is present when you are well awake and conscious - as you read this page - it is quite easy to identify large brain signatures of the state of consciousness, which can be measured, for example, with an electroencephalogram or a functional MRI. But once we have these famous signatures, it is interesting to explore the question of consciousness at the boundaries of our knowledge: will we find these famous signatures in a baby? In a non-communicating patient who is not known to be conscious or not? In non-human primates or in other animal species? And if, by any chance, these signatures are present, how will this change our very definition of consciousness that has been posed in a very limited situation: that of an educated, socialized, language literate adult?
One of these border explorations is to go to the brains of toddlers... what do neuroscience tells us about the cognitive functioning of babies?
Far from being a tabula rasa without any knowledge, the baby's mind (and therefore also his brain) is already rich in a host of high-level cognitive and neural skills, ready to be refined according to his experiences and learning. In terms of language, functional MRI studies have shown that, from the first months of life, babies' brains show a specialization in listening to language that already involves the specialized brain networks that we knew in adults, especially in the left hemisphere. On the psycho-linguistic level, we have known since the 1970s that at birth a human baby is able to distinguish all the phonemes that make up the different human languages. Then, gradually, he will strengthen his mastery of the phonemes (the elementary sounds of language that compose the syllables) to which he is exposed in his environment and he will lose his ability to deal with phonemes to which he is never exposed. Language, therefore, but also attention, social cognition, and even consciousness develop extremely early and we are beginning to be able to identify the main stages of this cognitive development that contributes to the constitution of the individual's subjective identity.
What is fascinating about the baby is that, rather than passively receiving information from the outside world, he is very proactively engaged in the learning necessary for his development. This can be seen in phenomena such as joint attention, which teaches people to pay attention to certain objects through exchanges of views between the adult, the baby and the object concerned. This confirms that an isolated brain does nothing, but that it constantly evolves in interaction with its environment and in contact with its fellow human beings.
Our old brains have well integrated the "Google effect".
Does this interaction with the other constitute one of the new frontiers of our knowledge, those of the links between the brain and the world around it?
I like to say that the brain in a jar is useless: it is by interacting with a body and its environment that it becomes the biological organ of our subjectivity. An individual's brain belongs to a body (our other organs) with which he or she constantly interacts, and it is located in a social body from birth and even before. A social body where exchanges with others, exposure to languages, culture, civilization and history will play a decisive role in the emergence of mental functions. Without early social interaction, there is no language learning...
In The Networkable Man, you compared the functioning of our society to the microcosm of our brain. As we are constantly interacting with digital technologies, does this change the way we think? Has our brain adapted to the tools it has created itself?
In fact, on the scale of evolution, whose time constants are most often in the order of hundreds or even millions of years, our homo sapien brain has not had time to evolve in a substantial genetic way over the past 6,000 years. Yet, during this brief wink, we left prehistory, invented writing and reading, and many other communication technologies, which are now more and more complex. In doing so, our old brains have adapted to an environment for which they were not genetically engineered. A human baby is born today with the same brain as a baby born in the time of Pericles. How then do we adapt to this dazzling wave of innovation? Thanks to the incredible brain plasticity we mentioned. Culture and all of our social interactions give rise to rich and permanent changes in the fine structure and activity of our brains. These modifications are the biological translation of our psychological transformations and our most diverse learning. Our cognitive strategies allow us, once again, to "make something new" and adapt to it, with our old brain. About the future of our brains, I like to quote an interesting discovery by Betsy Sparrow of Columbia University in New York. In a study published in Science in 2011, she and her colleagues showed that our minds have internalized the concept of search engines, what she calls the "Google effect": when faced with a difficult question for which we do not have an answer, we mentally activate, without our knowledge, the concepts of the usual search engines (Yahoo, Google...). This cognitive strategy is a cultural evolution.
For a very long time, neurons have taken all the attention, but researchers are also interested in other cells much less known and which play a crucial role in brain functions...
This has been true for years, glial cells for example are starred by neurons, whereas they are 10 times more numerous in our brain! Jean-Pierre Changeux's first real neuroscientific bestseller, published in 1983, was entitled L'homme neuronal... Glial cells are a bit like the glue of neurons, and group several types of cells called astrocytes, oligodendrocytes, or microglial cells.... And if they have long been underestimated for so long, it is because we thought that their role was reduced only to the functions of "housewives" of the brain, that they were confined to ensuring activities of feeding, protecting and cleaning the famous neurons. However, glial cells do perform these functions, but their role goes far beyond that. It was discovered about ten years ago that they are directly involved in the coding of information by neurons, that they can release neurotransmitters and that they actually play a very subtle neuromodulatory role.
Last year, Yves Agid and Pierre Magistretti signed a book entitled "Homme glial" (Éditions Odile Jacob), echoing Jean-Pierre Changeux's L'Homme neuronal, to highlight this "other half of the brain" that had long remained in the shadows. Understanding this decisive role of glial cells is a real revolution, opening new avenues in the treatment of neuropsychiatric diseases. In other words, a true understanding of how the brain works requires a detailed understanding of the role played by this brain "dark matter" and a further exploration of these new frontiers, beyond neurons....
Neuroscience raises many hopes, especially in the field of brain diseases... concretely, where are the therapeutic advances? Do patients benefit from advanced research?
Of course, there are already some applications. One example is the revolutionary neurostimulation technique first used in 1993 by Alim-Louis Benabid and Pierre Pollak on Parkinson's disease. By surgically placing electrodes in a deep area of the brain, the subthalamic nucleus, electrical impulses are emitted in a very targeted manner and some symptoms of Parkinson's disease are clearly corrected. But most often, from basic research to clinical practice, things do not proceed in a linear way, because there are breaks, paradigm shifts, over a fairly long period of time... With regard to the major challenges today, such as neurodegenerative diseases such as Alzheimer's or psychiatric diseases, schizophrenia, autism, knowledge is increasing, but it must be said that we are still waiting very much. There is a better understanding of the mechanisms of disease, but we do not yet know how to use this knowledge to heal patients suffering from it. Today there has been a conceptual revolution in neuroscience, but the therapeutic revolution in neurology and psychiatry is still to come. It is also a border that must be monitored, and that we hope to move...
