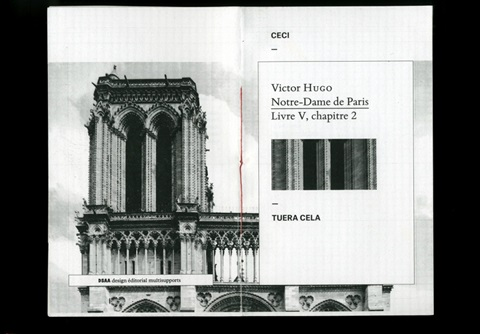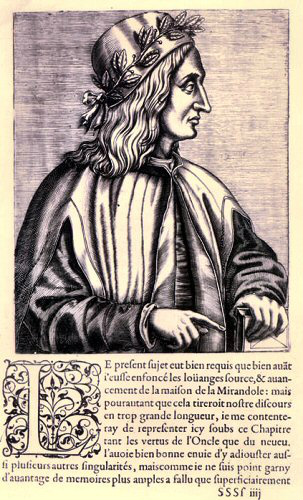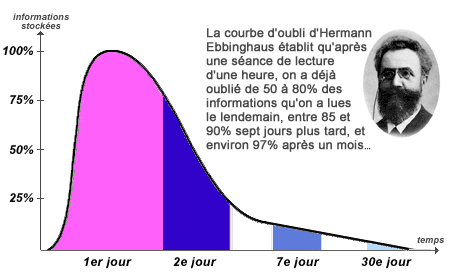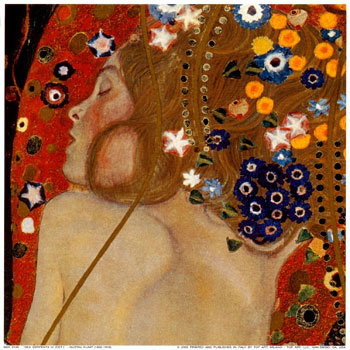Nos lectrices nous pardonneront de nous arrêter un moment pour chercher quelle pouvait être la pensée qui se dérobait sous ces paroles énigmatiques de l’archidiacre : Ceci tuera cela. Le livre tuera l’édifice.
À notre sens, cette pensée avait deux faces. C’était d’abord une pensée de prêtre. C’était l’effroi du sacerdoce devant un agent nouveau, l’imprimerie. C’était l’épouvante et l’éblouissement de l’homme du sanctuaire devant la presse lumineuse de Gutenberg. C’était la chaire et le manuscrit, la parole parlée et la parole écrite, s’alarmant de la parole imprimée ; quelque chose de pareil à la stupeur d’un passereau qui verrait l’ange Légion ouvrir ses six millions d’ailes. C’était le cri du prophète qui entend déjà bruire et fourmiller l’humanité émancipée, qui voit dans l’avenir l’intelligence saper la foi, l’opinion détrôner la croyance, le monde secouer Rome. Pronostic du philosophe qui voit la pensée humaine, volatilisée par la presse, s’évaporer du récipient théocratique. Terreur du soldat qui examine le bélier d’airain et qui dit : La tour croulera. Cela signifiait qu’une puissance allait succéder à une autre puissance. Cela voulait dire : La presse tuera l’église.
Mais sous cette pensée, la première et la plus simple sans doute, il y en avait à notre avis une autre, plus neuve, un corollaire de la première moins facile à apercevoir et plus facile à contester, une vue, tout aussi philosophique, non plus du prêtre seulement, mais du savant et de l’artiste. C’était pressentiment que la pensée humaine en changeant de forme allait changer de mode d’expression, que l’idée capitale de chaque génération ne s’écrirait plus avec la même matière et de la même façon, que le livre de pierre, si solide et si durable, allait faire place au livre de papier, plus solide et plus durable encore. Sous ce rapport, la vague formule de l’archidiacre avait un second sens ; elle signifiait qu’un art allait détrôner un autre art. Elle voulait dire : L’imprimerie tuera l’architecture.
En effet, depuis l’origine des choses jusqu’au quinzième siècle de l’ère chrétienne inclusivement, l’architecture est le grand livre de l’humanité, l’expression principale de l’homme à ses divers états de développement soit comme force, soit comme intelligence.
Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en per-dre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument.
Les premiers monuments furent de simples quartiers de roche que le fer n’avait pas touchés, dit Moïse. L’architecture commença comme toute écriture. Elle fut d’abord alphabet. On plantait une pierre debout, et c’était une lettre, et chaque lettre était un hiéroglyphe, et sur chaque hiéroglyphe reposait un groupe d’idées comme le chapiteau sur la colonne. Ainsi firent les premières races, partout, au même moment, sur la surface du monde entier. On retrouve la pierre levée des Celtes dans la Sibérie d’Asie, dans les pampas d’Amérique.
Plus tard on fit des mots. On superposa la pierre à la pierre, on accoupla ces syllabes de granit, le verbe essaya quelques combinaisons. Le dolmen et le cromlech celtes, le tumulus étrusque, le galgal hébreu, sont des mots. Quelques-uns, le tumulus surtout, sont des noms propres. Quelquefois même, quand on avait beaucoup de pierres et une vaste plage, on écrivait une phrase. L’immense entassement de Karnac est déjà une formule tout entière.
Enfin on fit des livres. Les traditions avaient enfanté des symboles, sous lesquels elles disparaissaient comme le tronc de l’arbre sous son feuillage ; tous ces symboles, auxquels l’humanité avait foi, allaient croissant, se multipliant, se croisant, se compliquant de plus en plus ; les premiers monuments ne suffisaient plus à les contenir ; ils en étaient débordés de toutes parts ; à peine ces monuments exprimaient-ils encore la tradition primitive, comme eux simple, nue et gisante sur le sol. Le symbole avait besoin de s’épanouir dans l’édifice. L’architecture alors se développa avec la pensée humaine ; elle devint géante à mille têtes et à mille bras, et fixa sous une forme éternelle, visible, palpable, tout ce symbolisme flottant. Tandis que Dédale, qui est la force, mesurait, tandis qu’Orphée, qui est l’intelligence, chantait, le pilier qui est une lettre, l’arcade qui est une syllabe, la pyramide qui est un mot, mis en mouvement à la fois par une loi de géométrie et par une loi de poésie, se groupaient, se combinaient, s’amalgamaient, descendaient, montaient, se juxtaposaient sur le sol, s’étageaient dans le ciel, jusqu’à ce qu’ils eussent écrit, sous la dictée de l’idée générale d’une époque, ces livres merveilleux qui étaient aussi de mer-veilleux édifices : la pagode d’Eklinga, le Rhamseïon d’Égypte, le temple de Salomon.
L’idée mère, le verbe, n’était pas seulement au fond de tous ces édifices, mais encore dans la forme. Le temple de Salomon, par exemple, n’était point simplement la reliure du livre saint, il était le livre saint lui-même. Sur chacune de ses enceintes concentriques les prêtres pouvaient lire le verbe traduit et manifesté aux yeux, et ils suivaient ainsi ses transformations de sanctuaire en sanctuaire jusqu’à ce qu’ils le saisissent dans son dernier tabernacle sous sa forme la plus concrète qui était encore de l’architecture : l’arche. Ainsi le verbe était enfermé dans l’édifice, mais son image était sur son enveloppe comme la fi-gure humaine sur le cercueil d’une momie.
Et non seulement la forme des édifices mais encore l’emplacement qu’ils se choisissaient révélait la pensée qu’ils représentaient. Selon que le symbole à exprimer était gracieux ou sombre, la Grèce couronnait ses montagnes d’un temple harmonieux à l’œil, l’Inde éventrait les siennes pour y ciseler ces difformes pagodes souterraines portées par de gigantesques rangées d’éléphants de granit.
Ainsi, durant les six mille premières années du monde, depuis la pagode la plus immémoriale de l’Hindoustan jusqu’à la cathédrale de Cologne, l’architecture a été la grande écriture du genre humain. Et cela est tellement vrai que non seulement tout symbole religieux, mais encore toute pensée humaine a sa page dans ce livre immense et son monument.
Toute civilisation commence par la théocratie et finit par la démocratie. Cette loi de la liberté succédant à l’unité est écrite dans l’architecture. Car, insistons sur ce point, il ne faut pas croire que la maçonnerie ne soit puissante qu’à édifier le temple, qu’à exprimer le mythe et le symbolisme sacerdotal, qu’à transcrire en hiéroglyphes sur ses pages de pierre les tables mystérieuses de la loi. S’il en était ainsi, comme il arrive dans toute société humaine un moment où le symbole sacré s’use et s’oblitère sous la libre pensée, où l’homme se dérobe au prêtre, où l’excroissance des philosophies et des systèmes ronge la face de la religion, l’architecture ne pourrait reproduire ce nouvel état de l’esprit humain, ses feuillets, chargés au recto, seraient vides au verso, son œuvre serait tronquée, son livre serait incomplet. Mais non.
Prenons pour exemple le moyen âge, où nous voyons plus clair parce qu’il est plus près de nous. Durant sa première période, tandis que la théocratie organise l’Europe, tandis que le Vatican rallie et reclasse autour de lui les éléments d’une Rome faite avec la Rome qui gît écroulée autour du Capitole, tandis que le christianisme s’en va recherchant dans les décombres de la civilisation antérieure tous les étages de la société et rebâtit avec ces ruines un nouvel univers hiérarchique dont le sacerdoce est la clef de voûte, on entend sourdre d’abord dans ce chaos, puis on voit peu à peu sous le souffle du christianisme, sous la main des barbares, surgir des déblais des architectures mortes, grecque et romaine, cette mystérieuse architecture romane, sœur des maçonneries théocratiques de l’Égypte et de l’Inde, emblème inaltérable du catholicisme pur, immuable hiéroglyphe de l’unité papale. Toute la pensée d’alors est écrite en effet dans ce sombre style roman. On y sent partout l’autorité, l’unité, l’impénétrable, l’absolu, Grégoire VII ; partout le prêtre, jamais l’homme ; partout la caste, jamais le peuple. Mais les croisades arrivent. C’est un grand mouvement populaire ; et tout grand mouvement populaire, quels qu’en soient la cause et le but, dégage toujours de son dernier précipité l’esprit de liberté. Des nouveautés vont se faire jour. Voici que s’ouvre la période orageuse des Jacqueries, des Pragueries et des Ligues. L’autorité s’ébranle, l’unité se bifurque. La féodalité demande à partager avec la théocratie, en attendant le peuple qui surviendra inévitablement et qui se fera, comme toujours, la part du lion. Quia nominor leo. La seigneurie perce donc sous le sacerdoce, la commune sous la seigneurie. La face de l’Europe est changée. Eh bien ! la face de l’architecture est changée aussi. Comme la civilisation, elle a tourné la page, et l’esprit nouveau des temps la trouve prête à écrire sous sa dictée. Elle est revenue des croisades avec l’ogive, comme les nations avec la liberté. Alors, tandis que Rome se démembre peu à peu, l’architecture romane meurt. L’hiéroglyphe déserte la cathédrale et s’en va blasonner le donjon pour faire un prestige à la féodalité. La cathédrale elle-même, cet édifice autrefois si dogmatique, envahie désormais par la bourgeoisie, par la commune, par la liberté, échappe au prêtre et tombe au pouvoir de l’artiste. L’artiste la bâtit à sa guise. Adieu le mystère, le mythe, la loi. Voici la fantaisie et le caprice. Pourvu que le prêtre ait sa basilique et son autel, il n’a rien à dire. Les quatre murs sont à l’artiste. Le livre architectural n’appartient plus au sacerdoce, à la religion, à Rome ; il est à l’imagination, à la poésie, au peuple. De là les transformations rapides et innombrables de cette architecture qui n’a que trois siècles, si frappantes après l’immobilité stagnante de l’architecture romane qui en a six ou sept. L’art cependant marche à pas de géant. Le génie et l’originalité populaires font la besogne que faisaient les évêques. Chaque race écrit en passant sa ligne sur le livre ; elle rature les vieux hiéroglyphes romans sur le frontispice des cathédrales, et c’est tout au plus si l’on voit encore le dogme percer çà et là sous le nouveau symbole qu’elle y dépose. La draperie populaire laisse à peine deviner l’ossement religieux. On ne saurait se faire une idée des licences que prennent alors les architectes, même envers l’église. Ce sont des chapiteaux tricotés de moines et de nonnes honteusement accouplés, comme à la salle des Cheminées du Palais de Justice à Paris. C’est l’aventure de Noé sculptée en toutes lettres comme sous le grand portail de Bourges. C’est un moine bachique à oreilles d’âne et le verre en main riant au nez de toute une communauté, comme sur le lavabo de l’abbaye de Bocherville. Il existe à cette époque, pour la pensée écrite en pierre, un privilège tout à fait comparable à notre liberté actuelle de la presse. C’est la liberté de l’architecture.
Cette liberté va très loin. Quelquefois un portail, une façade, une église tout entière présente un sens symbolique absolument étranger au culte, ou même hostile à l’église. Dès le treizième siècle Guillaume de Paris, Nicolas Flamel au quinzième, ont écrit de ces pages séditieuses. Saint-Jacques-de-la-Boucherie était toute une église d’opposition.
La pensée alors n’était libre que de cette façon, aussi ne s’écrivait-elle tout entière que sur ces livres qu’on appelait édifices. Sans cette forme édifice, elle se serait vue brûler en place publique par la main du bourreau sous la forme manuscrit, si elle avait été assez imprudente pour s’y risquer. La pensée portail d’église eût assisté au supplice de la pensée livre. Aussi n’ayant que cette voie, la maçonnerie, pour se faire jour, elle s’y précipitait de toutes parts. De là l’immense quantité de cathédrales qui ont couvert l’Europe, nombre si prodigieux qu’on y croit à peine, même après l’avoir vérifié. Toutes les forces matérielles, toutes les forces intellectuelles de la société convergèrent au même point : l’architecture. De cette manière, sous prétexte de bâtir des églises à Dieu, l’art se développait dans des proportions magnifiques.
Alors, quiconque naissait poète se faisait architecte. Le génie épars dans les masses, comprimé de toutes parts sous la féodalité comme sous une testudo de boucliers d’airain, ne trouvant issue que du côté de l’architecture, débouchait par cet art, et ses Iliades prenaient la forme de cathédrales. Tous les autres arts obéissaient et se mettaient en discipline sous l’architecture. C’étaient les ouvriers du grand œuvre. L’architecte, le poète, le maître totalisait en sa personne la sculpture qui lui ciselait ses façades, la peinture qui lui enluminait ses vitraux, la musique qui mettait sa cloche en branle et soufflait dans ses orgues. Il n’y avait pas jusqu’à la pauvre poésie proprement dite, celle qui s’obstinait à végéter dans les manuscrits, qui ne fût obligée pour être quelque chose de venir s’encadrer dans l’édifice sous la forme d’hymne ou de prose ; le même rôle, après tout, qu’avaient joué les tragédies d’Eschyle dans les fêtes sacerdotales de la Grèce, la Genèse dans le temple de Salomon.
Ainsi, jusqu’à Gutenberg, l’architecture est l’écriture principale, l’écriture universelle. Ce livre granitique commencé par l’Orient, continué par l’antiquité grecque et romaine, le moyen âge en a écrit la dernière page. Du reste, ce phénomène d’une architecture de peuple succédant à une architecture de caste que nous venons d’observer dans le moyen âge, se reproduit avec tout mouvement analogue dans l’intelligence humaine aux autres grandes époques de l’histoire. Ainsi, pour n’énoncer ici que sommairement une loi qui demanderait à être développée en des volumes, dans le haut Orient, berceau des temps primitifs, après l’architecture hindoue, l’architecture phénicienne, cette mère opulente de l’architecture arabe ; dans l’antiquité, après l’architecture égyptienne dont le style étrusque et les monuments cyclopéens ne sont qu’une variété, l’architecture grecque, dont le style romain n’est qu’un prolongement surchargé du dôme carthaginois ; dans les temps modernes, après l’architecture romane, l’architecture gothique. Et en dédoublant ces trois séries, on retrouvera sur les trois sœurs aînées, l’architecture hindoue, l’architecture égyptienne, l’architecture romane, le même symbole : c’est-à-dire la théocratie, la caste, l’unité, le dogme, le mythe, Dieu ; et pour les trois sœurs cadettes, l’architecture phénicienne, l’architecture grecque, l’architecture gothique, quelle que soit du reste la diversité de forme inhérente à leur nature, la même signification aussi : c’est-à-dire la liberté, le peuple, l’homme.
Qu’il s’appelle bramine, mage ou pape, dans les maçonneries hindoue, égyptienne ou romane, on sent toujours le prêtre, rien que le prêtre. Il n’en est pas de même dans les architectures de peuple. Elles sont plus riches et moins saintes. Dans la phénicienne, on sent le marchand ; dans la grecque, le républicain ; dans la gothique, le bourgeois.
Les caractères généraux de toute architecture théocratique sont l’immutabilité, l’horreur du progrès, la conservation des lignes traditionnelles, la consécration des types primitifs, le pli constant de toutes les formes de l’homme et de la nature aux caprices incompréhensibles du symbole. Ce sont des livres ténébreux que les initiés seuls savent déchiffrer. Du reste, toute forme, toute difformité même y a un sens qui la fait inviolable. Ne demandez pas aux maçonneries hindoue, égyptienne, romane, qu’elles réforment leur dessin ou améliorent leur statuaire. Tout perfectionnement leur est impiété. Dans ces architectures, il semble que la roideur du dogme se soit répandue sur la pierre comme une seconde pétrification. Les caractères généraux des maçonneries populaires au contraire sont la variété, le progrès, l’originalité, l’opulence, le mouvement perpétuel. Elles sont déjà assez détachées de la religion pour songer à leur beauté, pour la soigner, pour corriger sans relâche leur parure de statues ou d’arabesques. Elles sont du siècle. Elles ont quelque chose d’humain qu’elles mêlent sans cesse au symbole divin sous lequel elles se produisent encore. De là des édifices péné-trables à toute âme, à toute intelligence, à toute imagination, symboliques encore, mais faciles à comprendre comme la nature. Entre l’architecture théocratique et celle-ci, il y a la diffé-rence d’une langue sacrée à une langue vulgaire, de l’hiéroglyphe à l’art, de Salomon à Phidias.
Si l’on résume ce que nous avons indiqué jusqu’ici très sommairement en négligeant mille preuves et aussi mille objections de détail, on est amené à ceci : que l’architecture a été jusqu’au quinzième siècle le registre principal de l’humanité, que dans cet intervalle il n’est pas apparu dans le monde une pensée un peu compliquée qui ne se soit faite édifice, que toute idée populaire comme toute loi religieuse a eu ses monuments ; que le genre humain enfin n’a rien pensé d’important qu’il ne l’ait écrit en pierre. Et pourquoi ? C’est que toute pensée, soit religieuse, soit philosophique, est intéressée à se perpétuer, c’est que l’idée qui a remué une génération veut en remuer d’autres, et laisser trace. Or quelle immortalité précaire que celle du manuscrit ! Qu’un édifice est un livre bien autrement solide, durable, et résistant ! Pour détruire la parole écrite il suffit d’une torche et d’un turc. Pour démolir la parole construite, il faut une révolution sociale, une révolution terrestre. Les barbares ont passé sur le Colisée, le déluge peut-être sur les Pyramides.
Au quinzième siècle tout change.
La pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer non seulement plus durable et plus résistant que l’architecture, mais encore plus simple et plus facile. L’architecture est détrônée. Aux lettres de pierre d’Orphée vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg.
Le livre va tuer l’édifice.
L’invention de l’imprimerie est le plus grand événement de l’histoire. C’est la révolution mère. C’est le mode d’expression de l’humanité qui se renouvelle totalement, c’est la pensée humaine qui dépouille une forme et en revêt une autre, c’est le complet et définitif changement de peau de ce serpent symbolique qui, depuis Adam, représente l’intelligence.
Sous la forme imprimerie, la pensée est plus impérissable que jamais ; elle est volatile, insaisissable, indestructible. Elle se mêle à l’air. Du temps de l’architecture, elle se faisait montagne et s’emparait puissamment d’un siècle et d’un lieu. Maintenant elle se fait troupe d’oiseaux, s’éparpille aux quatre vents, et occupe à la fois tous les points de l’air et de l’espace.
Nous le répétons, qui ne voit que de cette façon elle est bien plus indélébile ? De solide qu’elle était elle devient vivace. Elle passe de la durée à l’immortalité. On peut démolir une masse, comment extirper l’ubiquité ? Vienne un déluge, la montagne aura disparu depuis longtemps sous les flots que les oiseaux voleront encore ; et, qu’une seule arche flotte à la surface du cataclysme, ils s’y poseront, surnageront avec elle, assisteront avec elle à la décrue des eaux, et le nouveau monde qui sortira de ce chaos verra en s’éveillant planer au-dessus de lui, ailée et vivante, la pensée du monde englouti.
Et quand on observe que ce mode d’expression est non seulement le plus conservateur, mais encore le plus simple, le plus commode, le plus praticable à tous, lorsqu’on songe qu’il ne traîne pas un gros bagage et ne remue pas un lourd attirail, quand on compare la pensée obligée pour se traduire en un édifice de mettre en mouvement quatre ou cinq autres arts et des tonnes d’or, toute une montagne de pierres, toute une forêt de charpentes, tout un peuple d’ouvriers, quand on la compare à la pensée qui se fait livre, et à qui il suffit d’un peu de papier, d’un peu d’encre et d’une plume, comment s’étonner que l’intelligence humaine ait quitté l’architecture pour l’imprimerie ? Coupez brusquement le lit primitif d’un fleuve d’un canal creusé au-dessous de son niveau, le fleuve désertera son lit.
Aussi voyez comme à partir de la découverte de l’imprimerie l’architecture se dessèche peu à peu, s’atrophie et se dénude. Comme on sent que l’eau baisse, que la sève s’en va, que la pensée des temps et des peuples se retire d’elle ! Le refroidissement est à peu près insensible au quinzième siècle, la presse est trop débile encore, et soutire tout au plus à la puissante architecture une surabondance de vie. Mais, dès le seizième siècle, la maladie de l’architecture est visible ; elle n’exprime déjà plus essentiellement la société ; elle se fait misérablement art classique ; de gauloise, d’européenne, d’indigène, elle devient grecque et romaine, de vraie et de moderne, pseudo-antique. C’est cette décadence qu’on appelle renaissance. Décadence magnifique pourtant, car le vieux génie gothique, ce soleil qui se couche derrière la gigantesque presse de Mayence, pénètre encore quelque temps de ses derniers rayons tout cet entassement hybride d’arcades latines et de colonnades corinthiennes.
C’est ce soleil couchant que nous prenons pour une aurore.
Cependant, du moment où l’architecture n’est plus qu’un art comme un autre, dès qu’elle n’est plus l’art total, l’art souverain, l’art tyran, elle n’a plus la force de retenir les autres arts. Ils s’émancipent donc, brisent le joug de l’architecte, et s’en vont chacun de leur côté. Chacun d’eux gagne à ce divorce. L’isolement grandit tout. La sculpture devient statuaire, l’imagerie devient peinture, le canon devient musique. On dirait un empire qui se démembre à la mort de son Alexandre et dont les provinces se font royaumes.
De là Raphaël, Michel-Ange, Jean Goujon, Palestrina, ces splendeurs de l’éblouissant seizième siècle.
En même temps que les arts, la pensée s’émancipe de tous côtés. Les hérésiarques du moyen âge avaient déjà fait de larges entailles au catholicisme. Le seizième siècle brise l’unité religieuse. Avant l’imprimerie, la réforme n’eût été qu’un schisme, l’imprimerie la fait révolution. Otez la presse, l’hérésie est énervée. Que ce soit fatal ou providentiel, Gutenberg est le précurseur de Luther.
Cependant, quand le soleil du moyen âge est tout à fait couché, quand le génie gothique s’est à jamais éteint à l’horizon de l’art, l’architecture va se ternissant, se décolorant, s’effaçant de plus en plus. Le livre imprimé, ce ver rongeur de l’édifice, la suce et la dévore. Elle se dépouille, elle s’effeuille, elle maigrit à vue d’œil. Elle est mesquine, elle est pauvre, elle est nulle. Elle n’exprime plus rien, pas même le souvenir de l’art d’un autre temps. Réduite à elle-même, abandonnée des autres arts parce que la pensée humaine l’abandonne, elle appelle des manœuvres à défaut d’artistes. La vitre remplace le vitrail. Le tailleur de pierre succède au sculpteur. Adieu toute sève, toute originalité, toute vie, toute intelligence. Elle se traîne, lamentable mendiante d’atelier, de copie en copie. Michel-Ange, qui dès le seizième siècle la sentait sans doute mourir, avait eu une dernière idée, une idée de désespoir. Ce titan de l’art avait entassé le Panthéon sur le Parthénon, et fait Saint-Pierre de Rome. Grande œuvre qui méritait de rester unique, dernière originalité de l’architecture, signature d’un artiste géant au bas du colossal registre de pierre qui se fermait. Michel-Ange mort, que fait cette misérable architecture qui se survivait à elle-même à l’état de spectre et d’ombre ? Elle prend Saint-Pierre de Rome, et le calque, et le parodie. C’est une manie. C’est une pitié. Chaque siècle a son Saint-Pierre de Rome ; au dix-septième siècle le Val-de-Grâce, au dix-huitième Sainte-Geneviève. Chaque pays a son Saint-Pierre de Rome. Londres a le sien. Pétersbourg a le sien. Paris en a deux ou trois. Testament insignifiant, dernier radotage d’un grand art décrépit qui retombe en enfance avant de mourir.
Si, au lieu de monuments caractéristiques comme ceux dont nous venons de parler nous examinons l’aspect général de l’art du seizième au dix-huitième siècle, nous remarquons les mêmes phénomènes de décroissance et d’étisie. À partir de François II, la forme architecturale de l’édifice s’efface de plus en plus et laisse saillir la forme géométrique, comme la charpente osseuse d’un malade amaigri. Les belles lignes de l’art font place aux froides et inexorables lignes du géomètre. Un édifice n’est plus un édifice, c’est un polyèdre. L’architecture cependant se tourmente pour cacher cette nudité. Voici le fronton grec qui s’inscrit dans le fronton romain et réciproquement. C’est toujours le Panthéon dans le Parthénon, Saint-Pierre de Rome. Voici les maisons de brique de Henri IV à coins de pierre ; la place Royale, la place Dauphine. Voici les églises de Louis XIII, lourdes, trapues, surbaissées, ramassées, chargées d’un dôme comme d’une bosse. Voici l’architecture mazarine, le mauvais pasticcio italien des Quatre-Nations. Voici les palais de Louis XIV, longues casernes à courtisans, roides, glaciales, ennuyeuses. Voici enfin Louis XV, avec les chicorées et les vermicelles, et toutes les verrues et tous les fungus qui défigurent cette vieille architecture caduque, édentée et coquette. De François II à Louis XV, le mal a crû en progression géométrique. L’art n’a plus que la peau sur les os. Il agonise misérablement.
Cependant, que devient l’imprimerie ? Toute cette vie qui s’en va de l’architecture vient chez elle. À mesure que l’architecture baisse, l’imprimerie s’enfle et grossit. Ce capital de forces que la pensée humaine dépensait en édifices, elle le dépense désormais en livres. Aussi dès le seizième siècle la presse, grandie au niveau de l’architecture décroissante, lutte avec elle et la tue. Au dix-septième, elle est déjà assez souveraine, assez triomphante, assez assise dans sa victoire pour donner au monde la fête d’un grand siècle littéraire. Au dix-huitième, longtemps reposée à la cour de Louis XIV, elle ressaisit la vieille épée de Luther, en arme Voltaire, et court, tumultueuse, à l’attaque de cette ancienne Europe dont elle a déjà tué l’expression architecturale. Au moment où le dix-huitième siècle s’achève, elle a tout détruit. Au dix-neuvième, elle va reconstruire.
Or, nous le demandons maintenant, lequel des deux arts représente réellement depuis trois siècles la pensée humaine ? lequel la traduit ? lequel exprime, non pas seulement ses manies littéraires et scolastiques, mais son vaste, profond, universel mouvement ? Lequel se superpose constamment, sans rupture et sans lacune, au genre humain qui marche, monstre à mille pieds ? L’architecture ou l’imprimerie ?
L’imprimerie. Qu’on ne s’y trompe pas, l’architecture est morte, morte sans retour, tuée par le livre imprimé, tuée parce qu’elle dure moins, tuée parce qu’elle coûte plus cher. Toute cathédrale est un milliard. Qu’on se représente maintenant quelle mise de fonds il faudrait pour récrire le livre architectural ; pour faire fourmiller de nouveau sur le sol des milliers d’édifices ; pour revenir à ces époques où la foule des monuments était telle qu’au dire d’un témoin oculaire « on eût dit que le monde en se secouant avait rejeté ses vieux habillements pour se couvrir d’un blanc vêtement d’églises ». Erat enim ut si mun-dus, ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, candidam eccle-siarum vestem indueret (GLABER RADULPHUS).
Un livre est si tôt fait, coûte si peu, et peut aller si loin ! Comment s’étonner que toute la pensée humaine s’écoule par cette pente ? Ce n’est pas à dire que l’architecture n’aura pas encore çà et là un beau monument, un chef-d’œuvre isolé. On pourra bien encore avoir de temps en temps, sous le règne de l’imprimerie, une colonne faite, je suppose, par toute une armée, avec des canons amalgamés, comme on avait, sous le règne de l’architecture, des Iliades et des Romanceros, des Mahabâhrata et des Niebelungen, faits par tout un peuple avec des rapsodies amoncelées et fondues. Le grand accident d’un architecte de génie pourra survenir au vingtième siècle, comme celui de Dante au treizième. Mais l’architecture ne sera plus l’art social, l’art collectif, l’art dominant. Le grand poème, le grand édifice, le grand œuvre de l’humanité ne se bâtira plus, il s’imprimera.
Et désormais, si l’architecture se relève accidentellement, elle ne sera plus maîtresse. Elle subira la loi de la littérature qui la recevait d’elle autrefois. Les positions respectives des deux arts seront interverties. Il est certain que dans l’époque architecturale les poèmes, rares, il est vrai, ressemblent aux monuments. Dans l’Inde, Vyasa est touffu, étrange, impénétrable comme une pagode. Dans l’orient égyptien, la poésie a, comme les édifices, la grandeur et la tranquillité des lignes ; dans la Grèce antique, la beauté, la sérénité, le calme ; dans l’Europe chrétienne, la majesté catholique, la naïveté populaire, la riche et luxuriante végétation d’une époque de renouvellement. La Bible ressemble aux Pyramides, l’Iliade au Parthénon, Homère à Phidias. Dante au treizième siècle, c’est la dernière église romane ; Shakespeare au seizième, la dernière cathédrale gothique.
Ainsi, pour résumer ce que nous avons dit jusqu’ici d’une façon nécessairement incomplète et tronquée, le genre humain a deux livres, deux registres, deux testaments, la maçonnerie et l’imprimerie, la bible de pierre et la bible de papier. Sans doute, quand on contemple ces deux bibles si largement ouvertes dans les siècles, il est permis de regretter la majesté visible de l’écriture de granit, ces gigantesques alphabets formulés en colonnades, en pylônes, en obélisques, ces espèces de montagnes humaines qui couvrent le monde et le passé depuis la pyramide jusqu’au clocher, de Chéops à Strasbourg. Il faut relire le passé sur ces pages de marbre. Il faut admirer et refeuilleter sans cesse le livre écrit par l’architecture ; mais il ne faut pas nier la grandeur de l’édifice qu’élève à son tour l’imprimerie.
Cet édifice est colossal. Je ne sais quel faiseur de statistique a calculé qu’en superposant l’un à l’autre tous les volumes sortis de la presse depuis Gutenberg on comblerait l’intervalle de la terre à la lune ; mais ce n’est pas de cette sorte de grandeur que nous voulons parler. Cependant, quand on cherche à recueillir dans sa pensée une image totale de l’ensemble des produits de l’imprimerie jusqu’à nos jours, cet ensemble ne nous apparaît-il pas comme une immense construction, appuyée sur le monde entier, à laquelle l’humanité travaille sans relâche, et dont la tête monstrueuse se perd dans les brumes profondes de l’avenir ? C’est la fourmilière des intelligences. C’est la ruche où toutes les imaginations, ces abeilles dorées, arrivent avec leur miel. L’édifice a mille étages. Çà et là, on voit déboucher sur ses rampes les cavernes ténébreuses de la science qui s’entrecoupent dans ses entrailles. Partout sur sa surface l’art fait luxurier à l’œil ses arabesques, ses rosaces et ses dentelles. Là chaque œuvre individuelle, si capricieuse et si isolée qu’elle semble, a sa place et sa saillie. L’harmonie résulte du tout. Depuis la cathédrale de Shakespeare jusqu’à la mosquée de Byron, mille clochetons s’encombrent pêle-mêle sur cette métropole de la pensée universelle. À sa base, on a récrit quelques anciens titres de l’humanité que l’architecture n’avait pas enregistrés. À gauche de l’entrée, on a scellé le vieux bas-relief en marbre blanc d’Homère, à droite la Bible polyglotte dresse ses sept tê-tes. L’hydre du Romancero se hérisse plus loin, et quelques autres formes hybrides, les Védas et les Niebelungen. Du reste le prodigieux édifice demeure toujours inachevé. La presse, cette machine géante, qui pompe sans relâche toute la sève intellectuelle de la société, vomit incessamment de nouveaux matériaux pour son œuvre. Le genre humain tout entier est sur l’échafaudage. Chaque esprit est maçon. Le plus humble bouche son trou ou met sa pierre. Rétif de la Bretonne apporte sa hottée de plâtras. Tous les jours une nouvelle assise s’élève. Indépendamment du versement original et individuel de chaque écrivain, il y a des contingents collectifs. Le dix-huitième siècle donne l’Encyclopédie, la révolution donne le Moniteur. Certes, c’est là aussi une construction qui grandit et s’amoncelle en spirales sans fin ; là aussi il y a confusion des langues, activité in-cessante, labeur infatigable, concours acharné de l’humanité tout entière, refuge promis à l’intelligence contre un nouveau déluge, contre une submersion de barbares. C’est laseconde tour de Babel du genre humain.